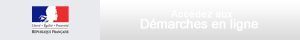L'ile du Broc racontée par Madame Marthe Elissondo
L'île du Broc?
C'était cinq hectares de terres fertiles, en forme de losange, émergeant du lit de l'Adour à l'endroit le plus large de son cours. Une seule métairie construite vers 1825. Terre d'accueil pour les pêcheurs, chasseurs, vacanciers
J'étais enfant unique, sous surveillance constante vu les dangers que l’eau représentait ; remous, courant et profondeur. J'ai donc vécu continuellement au contact des seuls adultes, d'où ces quelques souvenirs d'enfance
L'île du Broc appartenait à une vieille demoiselle qui possédait aussi l'île de Berens. L'île de Berens dépend d'Urt.
"Mademoiselle", les métayers l'appelaient ainsi et lui parlaient à la troisième personne. Mademoiselle venait une fois l'an en période d'été rendre visite à son métayer, mon père en l'occurrence. Assimiler cette visite à une inspection serait inexact. Mademoiselle aimait fouler le sol de sa propriété. Débarquant de son couralin, Mademoiselle apparaissait habillée de noir, robe longue à l'ancienne, étroit ruban blanc et noir faisant office de collier, petit chignon posé sur le haut de sa tête. Une ombrelle noire la préservait des rayons du soleil; ses chaussures me fascinaient littéralement; des bottines noires avec une débauche de petits boutons et recouvertes d'un protège chaussures.
Mon père la guidait dans sa promenade, fier de lui montrer l'entretien parfait des terres; elle, satisfaite du soin apporté aux cultures, condition première pour obtenir une récolte abondante. Mon père raccompagnait Mademoiselle jusqu'à sa barque et attendait que celle-ci s'éloigne.
A l'automne, certaines années, le régisseur venait apporter de la part de Mademoiselle des arbres fruitiers à planter. Les fruits étaient pour le métayer. Chantier de réparation couralin –bachets
Parfois, Mademoiselle écrivait à mon père pour lui demander de l'attendre à la descente du train (nous avions la chance de bénéficier d'un arrêt) pour la conduire en bateau jusqu'à l'Île de Berens.
Par déférence mon père nettoyait au mieux le cou ralin. Mademoiselle n'étant plus très jeun e, avait quelques difficultés pour emba rquer. Mon père maintenait la barque à terre et se plaçait de façon telle que Mademoiselle puisse poser la main sur son dos pour enjamber le bord de l'embarcation. Le métayer ne tendait pas la main à Mademoiselle pas même pour l'aider.
Ma grand-mère Antoinette, ses fils, Henri, Joseph, Arnaud, tous trois célibataires sont venus s'installer sur l'île après la grande guerre, pour pouvoir exercer, plus facilement, leurs activités de marins-pêcheurs. La pêche était une source de revenus; de plus les marins-pêcheurs cotisaient pour une retraite qu'ils obtenaient à cinquante ans. A ce moment-là les fonctionnaires seuls bénéficiaient cie cet avantage.
La vie sur l'Île avait ses inconvénients et ses exigences: la traversée du fleuve plusieurs fois par jour, l'inondation, la nécessité d'engager un va let de ferme, la surveillance et l'entretien des embarcations, le statut du métayage (moitié pour le patron et moitié pour le métayer, la récolte (le régisseur assistait au partage), les redevances (6 paires de poulets dans l'année, une alose à la saison de la pêche). Le produit de la basse-cour, poules, poulets, canards, oies, dindons hors la redevance était pour le métayer.
Lorsque nous avons quitté l'île en 1941, le statut n'avait pas changé.
La terre de l'île d'un haut rendement était facile à travailler; le fumier seul l'amendait. On ne peut établir de comparaison entre les superficies travaillées alors et celles de nos jours. L'île comptait cinq hectares. Sur le même lopin de terre en plus de la culture principale -qui était le maïs-une variété montante de haricots, très productive, était semée; le pied de maïs servait de tuteur. Dans le même sillon des citrouilles poussaient. Les unes agrémentaient nos soupes, les autres nourrissaient les animaux domestiques. Les navets fourragers y trouvaient aussi leur place. Le maïs était biné. Cette façon de cultiver nécessitait de la main-d’œuvre, le temps et la peine n'étaient pas comptés. Avant maturité du maïs, l'écimage était pratiqué; ce dernier séché et stocké fournissait un fourrage d'appoint pour l'hiver. Le jardin potager couvrait nos besoins en légumes; la récolte de pommes de terre était toujours très abondante. Le verger nous offrait ses fruits pour la table et les confitures; la gelée de pommes aux cerneaux de noix était un délice. La viande nous était fournie par les animaux de la basse-cour et les porcs que nous élevions. Le poisson 1 Nous le pêchions. L'autarcie était notre mode de vie.
Au début du mois d'Août, l'approvisionnement en litière, pour une année, s'imposait. L'Île n'en produisant pas, il fallait l'importer. C'était du jonc que l'on fauchait dans les "barthes" (champs humides en bordure de l' Ardanavy). Pour ce travai 1 le coefficient de marée le plus bas était choisi.
C'était une tâche pénible effectuée souvent par une chaleur accablante et comptant plusieurs manutentions. La main d’œuvre bénévole ne faisait pas défaut. Les bras d’Henri, Georges, Léon, Jean-, Baptiste et Pierre étaient les bienvenus.
Trois chars à boeufs étaient requis pour amener le jonc jusqu'au "gabarrot" grand bac faisant partie de la flottille de l'île.
1 ère manutention: charger la charrette
2ème manutention: décharger la charrette dans le "gabarrot"
3ème manutention: décharger le "gabarrot" et dresser la meule.
Après l'effort tous se retrouvaient autour de la table. M a mère confectionnait de délicieuses omelettes aux piments, elle retirait des pots de grès soit des confits de porc, de canard. Le jambon aussi était au menu; puis venait le fromage de Hollande, vi n à volonté. Le café accompagné d'une eau de vie blanche, distillée à la ferme par un oncle frère de ma mère clôturait le repas. La journée s'achevait sur une note de gaieté.
L'inconvénient majeur perturbant la vie sur l'île était l'inondation. L'eau nous rendait visite dans la maison durant trois jours une ou deux fois l' an. Quand je dis dans la maison, c'est le rez-de-chaussée qui était recouvert par les eaux; c'est-à-dire étable et grange. La hauteur d'eau atteignait 1,50 mètre. Le jardin seul était préservé. Les pièces habitées se situaient au premier étage.
Pour que l'Adour déborde il fallait qu'il y ait une grosse tempête et simultanément un coefficient de marée très élevé. De toute manière nous n'étions pas pris en traître et mon père agissait en conséquence. Les bêtes étaient parquées dans un hangar surélevé. Nous faisions provision de bois. Une grande échelle était placée sous la fenêtre de la cuisine, une barque amarrée à son pied. Les portes de l'étable et de la grange assujetties solidement (l'eau en se retirant pouvait emporter des objets). Nous attendions ...
En personne bien élevée, la " visiteuse" ne s'incrustait pas. Elle occupait les lieux durant quatre heures puis elle se retira it sachant qu'elle reviendrait très bientôt à la prochaine marée. Nous utilisions le temps de son absence pour nourrir les bêtes et remonter du bois.
En 1931 la crue s'annonçait très forte, le service des ponts et chaussées nous avait demandé d'évacuer l'île. Les vaches traversèrent l'Adour dans le "gabarrot" le voisin Georges les logea dans son étable. Mon père et le valet de ferme ne voulant pas quitter l'île, nous partîmes ma mère et moi chez mon oncle Joseph et tante Eugénie qui habitaient près du bourg. Ils nou s hébergèrent jusqu'à ce que tout rentra dans l'ordre.
Pour moi, enfant, et pour m'exprimer comme les jeunes : l'Inondation, cétait : "génial".
La pêche commençait début janvier pour se terminer en juin. Le mode de pêche était la senne. Deux embarcations associées permettaient de faire l'économie d'un pêcheur, donc sept pêcheurs au lieu de huit. Un homme restait toujours à terre pour ramener indifféremment l'un où l'autre filet.
Le fonctionnement:
Sur chaque barque montaient deux hommes, l'un ramait pour diriger celle-ci, l'autre jetait le filet à l’eau. Lorsque le filet était déployé il barrait les trois quarts de l'Adour (cent cinquante mètres environ). A terre, sur l'île, le cordier maintenait l'extrémité de la senne, en général ce travail était accompli par le plus leste et le plus robuste de l'équipage. Au signal du cordier le couralin revenait à terre rapidement. L'enroulement de la corde qu'il ramenait se faisait au cabestan. La poche était refermée. La senne ramenée à terre provoquait la joie ou la déception, jamais le découragement et cela plusieurs fois par marée. Le plus gros coup de filet dont je me souviens: huit saumons et une cinquantaine d'aloses. La saison de l'alose battait son plein en mai. Chaque pose ramenait de cinquante à cent aloses; de janvier à mars, le saumon était roi. Les premières aloses apparaissaient en avril ; les saumons étaient plus petits mais n'avaient pas déserté l'Adour.
Le cri de joie des pêcheurs lorsqu'ils avaient pris un saumon et qu'ils voulaient le faire savoir aux autres pêcheries était le " Pourrilleut" l'équivalent de l' " Irinzina " avec quelques variantes.
Les conditions de vie des pêcheurs étaient particulièrement dures. L'hiver, au contact de l'eau froide, leurs mains étaient crevassées. Pourtant, rien n'entamait leur bonne humeur comme de grands enfants ils étaient toujours prêts à se jouer. Quelques bons tours. Dura les mois qu'ils passaient ensemble, il n'y avait chez eux pas l'ombre d'un malentendu p un tiraillement mais une entente parfaite. Ils étaient des sages...
La graine en est-elle perdue?
A la fin de la marée, l'expéditeur grossiste à bord de son bateau à moteur passait pour collecter le poisson.
La Pentecôte était vécue par les pêcheurs comme un temps fort. C'était les fêtes du Port et ils y participaient. Le port de l'époque comptait deux commerçants:
Chez "Marthe" débit de boisson, de tabac, restaurant, épicerie.
Chez "Marie-Eugénie" idem moins tabac.
Les fêtes duraient deux jours, dimanche et lundi; elles étaient courues. Un orchestre de cuivres animait le bal qui commençait le dimanche après-midi pour s'interrompre à l'heure du dîner et reprendre ensuite jusqu'à minuit, heure à laquelle un feu d'artifice faisait la joie et l'admiration de tous. Le bal s'arrêtait vers une heure trente.
Le lundi midi, les pêcheurs accueillaient les musiciens sur l'île pour l'apéritif-concert. Dans l'après-midi, les pêcheurs de l'île et ceux des pêcheries voisines organisaient des jeux nautiques. Une demi-douzaine de "couralins", autant de "chalands" entraient en lice pour une course. Les rois de la compétition étaient les" cuviers ". Le participant devait savoir nager parfaitement, sa position dans le cuvier était inconfortable; il se tenait à genoux. Avec l'aide d'une grande spatule, il maintenait son esquif en flottaison, le guidait, le faisait avancer, évitait qu'il ne chavire avant d'atteindre son but. Malgré toutes ces précautions un bon bain forcé n'était pas exclu. Ces navigateurs insolites revenaient à terre sous les applaudissements d'un public enthousiaste. La fête continuait fort dans la nuit ...
couralin : barque à l'avant rectangulaire utilisée pour la pêche et la plaisance.
chaland: en plus petit la gondole "Vénitienne", utilisé pour la pêche à la senne.
cuvier: récipient en bois cerclé de fer utilisé par nos grand-mères pour faire la lessive spatule: la spatule servait à pétrir la farine de maïs dans la maie pour en faire un pain que l'on appelait " méture ". La spatule servait également à pétrir la farine de blé pour faire le pain. Pour les cochonnailles elle avait sa place dans les granc chaudrons de cuivre pour remuer la graiss et faire cuire les confits. Quand aux chasseurs bayonnais, ils rentraient chez eux par le train de treize heures; le lendemain les voyait revenir. Avec les canards sauvages qu'ils rapportaient, leurs épouses cuisinaient de fameux confits.
Parmi les pêcheurs certaines figures me reviennent en mémoire: Philippe le basque, mort avant d'avoir atteint l’âge de la retraite, homme au physique agréable, jovial, commerçant en seconde activité Maurice le landais, exploitant agricole en sus de la pêche, une force de la nature, d'humeur toujours égale, le rire communicatif, la voix forte. Son"Pourrilleut" était caractéristique.
Le cadre agréable de l’ile et son charme attiraient des visiteurs. Un grand couturier parisien, Jean PATOU, accompagné d'amis et de son personnel venait aux beaux jours passer une journée sur l'île. Le couturier possédait un magnifique canot automobile "l'Atout Ill" en bois de Teck jaugeant 9,72 tonneaux, muni d'un moteur de 220 chevaux. Lancé à pleine vitesse, il se cabrait et déchirait l'Adour en deux gerbes d'eau. Les embarcations amarrées le long des berges pour saluer son passage dansaient... dansaient...
Pour accoster, le canot effectuait un demi-cercle et se présentait face au courant Deux matelots, gaffe en main, maintenaient celui-ci à bonne distance pour lancer la passerelle afin que les visiteurs puissent débarquer. Les pêcheurs étaient contents de la voir arriver. La journée était bénéfique pour eux : un saumon vendu à un bon prix, puis comme le couturier était large, quelques bonnes bouteilles leur étaient offertes. Le couturier s'installait pour pique-niquer dans la partie boisée de l’ile, là où se situaient les pêcheries. Aussi, pour ne pas le gêner, l’espace d'une marée, ils ralentissaient leurs activités et se détendaient en prenant un bon repas en commun. Chose curieuse, c'était toujours après ce genre de repas qu'une frénésie de compétition les saisissait Ils organisaient des épreuves: course à pied, saut à la perche, lutte.
Parmi les invités du couturier, j'ai eu le privilège de voir "Charlot" accompagné d'une artiste américaine appelée la mystérieuse Mary. Le couturier et ses invités se retiraient tard dans la nuit à bord de l'Atout III.
En plus des pêcheurs, des chasseurs, la maison sur L’ile avait ses hôtes. Un oncle de mon père que l'on nommait 'Ménoune', mot familier désignant l'oncle (équivalent de Tonton), venait passer Cinq mois de l'année avec nous. Ménoune était veuf et retraité des renseignements généraux (de l'époque). Il était âgé lorsque je l'ai connu. Tous les jours, il faisait sa promenade dans l'île. Il s'habillait comme pour sortir en ville: costume, col dur, cravate, chaussures de cuir J'avais quatre ans, j'aurais pris plaisir à marcher à ses côtés, si par mesure de sécurité (le danger de l'eau était toujours présent) il n'avait attaché une corde à mon poignet Ce manque de liberté n'étart pas de mon goût Un jour, au cours de notre sortie, nous avons eu un différend, je lui ai mal répondu. En rentrant, il dit à mon père: "II est grand temps de la corriger"
Après chaque promenade il cirait ses chaussures, elles étaient prêtes pour le lendemain. Du temps de Ménoune, la femme au foyer gâtait beaucoup son mari ; aussi Ménoune avait ses manies alimentaires. Au petit déjeuner, il prenait de la 'Maizena'. A midi, comme boisson, l'eau bouillie, tiède, sucrée s'imposait A seize heures, une infusion qui pouvait selon sa couleur lui apporter ses bienfaits ou l'incommoder.
Quand prenait fin la saison d'été, ma mère était contente.
Marie la blanchisseuse avait une soixantaine d'années lorsque que je l'ai connue; elle venait tous les quinze jours pour faire la lessive. Jeune, elle avait travaillé durement pour élever ses six enfants. Son mari étant doté d'une petite santé, c'est elle qui faisait bouillir la marmite.
Laver le linge autrefois était une tâche pénible. Marie qui n'était plus très agile mettait deux jours pour venir à bout de son travail. Elle arrivait en début d'après-midi ce qui lui permettait de mettre le linge à tremper ; le valet de ferme lui apportait l'eau nécessaire puis elle goûtait, tout en racontant quelques petits potins à ma mère.
L'hiver la nuit venait vite, nous dînions tôt, puis toute la maisonnée se rassemblait autour d'un grand feu, ce dernier éclairait davantage la pièce que les lampes utilisées. Après quelques échanges de propos, chacun regagnait sa chambre.
Tôt le matin Marie entreprenait le lavage. A l'époque les draps étaient lourds, les détergents peu performants, les textiles lins, métis, coton, difficiles à manier: journée pénible pour Marie.
Celle-ci gardait son énergie grâce à son solide appétit. Au lever Marie prenait du café, puis vers neuf heures, elle déjeunait à la fourchette ; jambon, oeufs le tout arrosé d'un bon verre de vin.
Les autres repas étaient pris comme tout le monde. Lorsque le linge était lavé celui-ci était placé dans la lessiveuse, on le recouvrait d'eau aux fins d'ébullition. Vu la capacité de la lessiveuse, Marie passait près de deux heures à alimenter le feu pour obtenir ce résultat. Voilà la journée bien remplie
Il restait pour le lendemain le rinçage. Celui-ci se faisait à bord du couralin ; Marie avait besoin d'aide pour fixer la planche à laver au bord de la barque, puis pour lui porter le baquet, lourd, de linge. Rarement (mais ça se produisait) une petite pièce de linge était emportée par la rapidité du courant Marie terminart son travail dans la matinée. Elle prenait le repas de midi sur l'île, puis repartait.
Marie avait eu une grosse peine. Un de ses fils prénomrné Maurice âgé de vingt ans, garçon de ferme à nie de Berens, avait été victime d'un accident de la navigation.
Maurice avait amarré sa barque pour se faire remorquer à la poupe de "l'Eclair". Au cour de la manoeuvre de largage, la barque ne s'étant pas éloignée assez rapidement, la péniche qui suivait l'avait prise par le travers : la barque chavira. Bien que sachant nager, Maurice se noya.
Chaque fois que Marie voyait passer le remorqueur, de grosses larmes coulaient sur ses joues. L'émotion me gagnait... mais l'enfant que j'étais ne comprenait pas que ce chagrin si vif, toujours renouvelé, puisse durer si longtemps.
Forges de Boucau avec leur chargement de pierre.
L'exploitant de la carrière d'Urcuit avait trois bateaux ''l'inattendu, Alice, Passe-Partout'. La pierre qu'ils transportaient était aussi pour le Boucau. Leur port d'attache étart Urcuit.
Le Gave-Adour et le Michel descendaient de Peyrehorade transportant le galet concassé pour le revêtement des routes. Le jeudi, "A tout ha", pinasse ayant son port d'attache à Urt prenait à son bord, voyageurs, bestiaux, grains. Comme son nom "indique, "bon à tout faire", ses services n'étaient pas limités. Le soir chacun d'eux regagnait son port d'attache.
L'été, certains après-midi, quelques équipages de pêcheurs munis de petits filets remontaient à la rame jusqu'au lieu dit "Le Platane" où parfois jusqu'au "Bec du Gave" pour pêcher les muges ou mulets. C'était un poisson difficile à capturer. La pêche se pratiquait par les nuits sans lune. Le fleuve n'était pas pollué, les mulets avaient une chair appréciée.
Quelques années plus tard, les muges se pêchèrent à la ligne et en plein jour.
Un pêcheur professionnel de Bayonne possédait un couralin à moteur. Ce dernier était placé en son milieu et protégé par un habitacle en bois. Il était le seul à pêcher les muges au cordeau et comptait environ deux cent cinquante hameçons boëtés au ver de vase.
De temps à autre arrivait un immense radeau fait de bois de flottage : des troncs de pins assemblés et retenus par des liens fabriqués avec des jeunes chênes ou des branches de ce même bois entrelacées. Le radeau partait de Tartas à destination de Bayonne. Il était guidé par deux hommes ; la marée descendante le portait Il faisait escale pour la nuit au Port d'Urcuit. Une plate-forme recouverte d'une épaisse couche de branches de bruyère et surmontée d'une cabane bâchée tenait lieu d'abri aux bateliers qui passaient la nuit à bord du radeau. Toujours durant l'été les voiliers nous offraient leur ballet
L'électricité nous faisant défaut, l’heure solaire n'arrangeant pas les choses, les soirées d'hiver étaient longues sur l'île, mais quelle douceur les imprégnait.. . Un grand feu flambait. Après le dîner, chacun s'installait autour. Mon père dans un fauteuil de paille, ma mère faisant office de lectrice rapprochait sa chaise du chenet sur lequel était posé la lampe
Le valet de ferme, Auguste, s'installait dans un coin, je m'asseyais sur petit banc à côté de mon père. Note contraignante pour moi' le silence absolu de rigueur.
L’information apportée par le quotidien
"La Petite Gironde" était là !...
Auguste ne s'attardait pas. Il prenait sa lampe et après nous avoir souhaité une bonne nuit, il allait se coucher. La lecture commençait par la politique: la S.D.N., la vie chère, la retraite desvieux travail leurs, l'affaire Stavisky, la guerre d'Espagne, la menace d'un nouveau conflit avec l'Allemagne me reviennent en mémoire
Puis, venaient les faits divers et pour détendre l'atmosphère "les réclames" comme on disait: les poudres de "Cok" qui supprimaient les douleurs digestives, la crème "Tokalon qui garantissait une éternelle jeunesse !..
Mes parents commentaient les articles lus, prévoyaient le travail du lendemain. Le feu baissait, nous allions nous coucher.
Fin octobre, le maïs était mur, La cueillette s'effectuait à la main. Un temps sec était de rigueur, en vue d'une bonne conservation. Le char à bœufs, "le Brass" se transformait en tombereau grâce à des ridelles. Les épis de maïs avec leur enveloppe étaient volumineux. Pour une superficie de quatre hectares, le ramassage durait plusieurs jours; le maïs engrangé, le métayer était satisfait !...
La seconde phase de travail ou ' Despourguère' était agréable. Nos voisins du "Port d'Urcuit" hommes et femmes, ces dernières couvertes de grands châles (en octobre les nuits sont fraîches), venaient nous aider. Les barques, lanternes tempête à bord arrivaient sur l'île vers 19 heures. Chacun apportait son outil de travail le Cabilloun, chevillette pointue en bois, munie d'une ganse de cuir, en son milieu, afin d'y glisser le médius et l'annulaire de la main droite. A performance égale, certains préféraient une pointe de 15 cm reliée au poignet par une ficelle pour éviter de la perdre. Tout le monde prenait place autour de l'imposante montagne de maïs. Des corbeilles posées sur ce promontoire attendaient les épis ; un tri s'effectuait les beaux dans tel panier, les souffreteux dans tel autre. L'éclairage était dispensé par des lampes accrochées aux poutres. La tâche, facile en somme, consistait à séparer l'épi de son enveloppe, Cette dernière était ouverte au moyen du 'Cabilloun' puis rabattue ; l'épi aux grains roux brillants apparaissait.
Malgré la monotonie du travail, l'ambiance était pleine de gaieté, les rires, les chants maintenaient tout le monde éveillé. Conscients de la complaisance de nos voisins et ne voulant pas abuser d'eux, mes parents donnaient le signal d'arrêt vers 23 heures. Tout le monde se retrouvait dans la grande cuisine éclairée par un bon feu au premier étage, devant une collation, faite de pain, fromage, châtaignes, noix, Comme boisson : vin rouge, café, chocolat.
Les conversations étaient animées. Parfois, une note de tristesse s'y glissait ; le souvenir de la grande guerre, toujours vivant, revenait en mémoire ; les visages d'amis disparus étaient évoqués. Evoquées aussi les batailles de la Somme, de la Champagne, de Verdun, des Dardanelles car bon nombre d'Urcuitois étaient marins ou fantassins de la marine
Puis l'optimisme revenait la vie reprenait ses droits.
Vu l'animation qui régnait, les douze coups de minuit étaient loio lorsque nos voisins regagnaient leurs barques. Nous, les insulaires, les suivions du regard, notre imagination voyait des grandes lucioles qui folâtraient avant d'atteindre la rive…
Bien qu'appartenant à une pêcherie voisine de l'île, je voudrais citer deux frères jumeaux inséparables: Jean-Baptiste et Pierre, tous deux célibataires, La maison qu'ils habitaient n'est plus qu'une ruine sur le parcours de santé longeant l'Ardanavy.
Comme biens, ils possédaient un attelage de vaches et une charrette. En dehors de la pêche, ils se louaient à la journée chez les exploitants agricoles pour aider aux travaux de la ferme. Ils faisaient aussi du charroi. L'un des deux frères aimait la musique et jouait de l'harmonica. Parfois après une journée de travail, pour se détendre, ils s'arrêtaient au café pour boire un verre de vin; certaines fois davantage.
L'attelage attendait patiemment.
Comme le vin les rendait gais, le chemin du retour s'effectuait tardivement, en chantant, au son de l'harmonica. A l'époque on pouvait se le permettre, la circulation était inexistante.
Jean-Baptiste et Pierre avaient le sens de la convivialité. Dans notre village, un nouveau pasteur avait été nommé, L'ancien nous quittait après nous avoir guidés durant quarante cinq années. Le nouveau curé passait de maison en maison pour faire la connaissance de ses ouailles, A son arrivée dans la paroisse, monsieur le Curé se déplaçait en vélo et portait la soutane. Lorsque notre prêtre se rendit chez Jean-Baptiste et Pierre, ceux-ci sensibles à l’honneur qui leur était fait, craignant de le recevoir trop petitement, embarquèrent monsieur le Curé et son vélo dans le chaland et conduisirent, en chantant et en musique, chez 'Marthe" qui leur prépara une collation.
Après quinze années passées parmi nous, monsieur le Curé nous quitta pour exercer son sacerdoce dans une paroisse voisine. Lorsque l'occasion se présentait il avait plaisir à évoquer cette visite.
EN CONCLUSION
L’ile d'aujourd'hui est plantée de carolins, le flux lui grignote, un peu tous les jours, la pointe Ouest, Comme honteuse de sa déchéance, par dignité, elle ferme sa porte, Seule la petite plage de sable gris nous tolère l'espace d'une marée. Toutefois, pour les aigrettes, les hérons, les sternes, les canards, les sarcelles, les cormorans, c'est un paradis.
Pour ma part, je la remercie pour les années d'insouciance que son hospitalité m'a fait vivre
Merci à Mme Elissondo d'avoir accepté de nous confier son témoignage de vie passée sur l’ile du Broc.
Article paru dans les Bulletin Municipaux 2003 et 2004