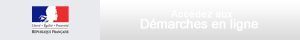Le gisement salin du bassin aquitain est issu de dépôts marins âgés de plusieurs millions d’années. La veine est située entre 600 et 8000 mètres de profondeur, avec une épaisseur de 500 à 1500 mètres. Les gisements sont exploitables lorsque les phénomènes géologiques ont provoqué des remontées de la veine vers la surface. Ces remontées sont appelées « écailles » à Urcuit.
Les salines d'Urcuit au fil du temps
Les communes de Mouguerre et Briscous possèdent, comme Urcuit, des gisements de sel gemme. Cependant, le gisement d’Urcuit est aujourd’hui le seul à être encore exploité. (Brochure « Salines Cérébos et de Bayonne », Mouguerre, European Salt Company (ESCO).
Le sel servait principalement à la conservation des aliments (poisson etc.) et à la salaison des jambons. Les gisements de ces communes ont depuis longtemps été utilisés à ces fins.
En 1840, une Loi sur le Sel, oblige par ordonnance Royale, que les exploitations de sels fournissent un minimum de 500 000 kg par an.
La première saline industrielle fut établie à Mousserolles et son eau servit à alimenter les thermes de Biarritz.
En 1917, Fabius Henrion crée à Mouguerre la « Société Anonyme de la Soude Française »; en 1918, cette même société adopte le nom de « Société étude et Produits Chimiques ».
En 1927, un groupe Belge du nom de Solvay, inventeur du carbonate de soude, rachète l’usine et exploite les gisements de Briscous (qui arrivent vite à saturation) puis d’ Urcuit. En 1966, les activités de la soudière prennent fin et la société se tourne vers la production de sel. Aujourd’hui la société Cérébos a repris cette activité sur Mouguerre. (Brochure « Salines Cérébos et de Bayonne », Mouguerre, European Salt Company (ESCO)
La technique employée pour extraire le sel est généralement la suivante : on injecte de l’eau de l’Adour dans le forage fait au sein du gisement. On achemine ensuite cette eau chargée en sel (saumure) vers l’usine de Mouguerre, via de « saumoduc ». L’eau est alors traitée, épurée, par évaporations successives afin d’isoler le sel cristallisé. Celui-ci est alors essoré et séché pour obtenir du sel fin.
Au XIXe et début du XXe siècle, le sel était une denrée très convoitée et considérée comme une richesse. C’est pour cela que l’on retrouve, par exemple, la trace de casernes de douaniers (en ruines) qui étaient alors chargés de surveiller les flux de sel et d’arrêter les exploitations clandestines.
L’exploitation de salines à Urcuit est la seule qui perdure de nos jours. Elle regroupe une superficie de 80 ha, et produit 62000 tonnes de sel par an.
Association: SAINT HUBERT
Association: CLUB ARDANAVY
Association: URKETAN KANTUZ
Association: URCUIT EVASION
Association: CLUB ARDANAVY
Association: CLUB ARDANAVY
Association: ARDANAVY FOOTBALL CLUB
Association: TENNIS CLUB URCUIT